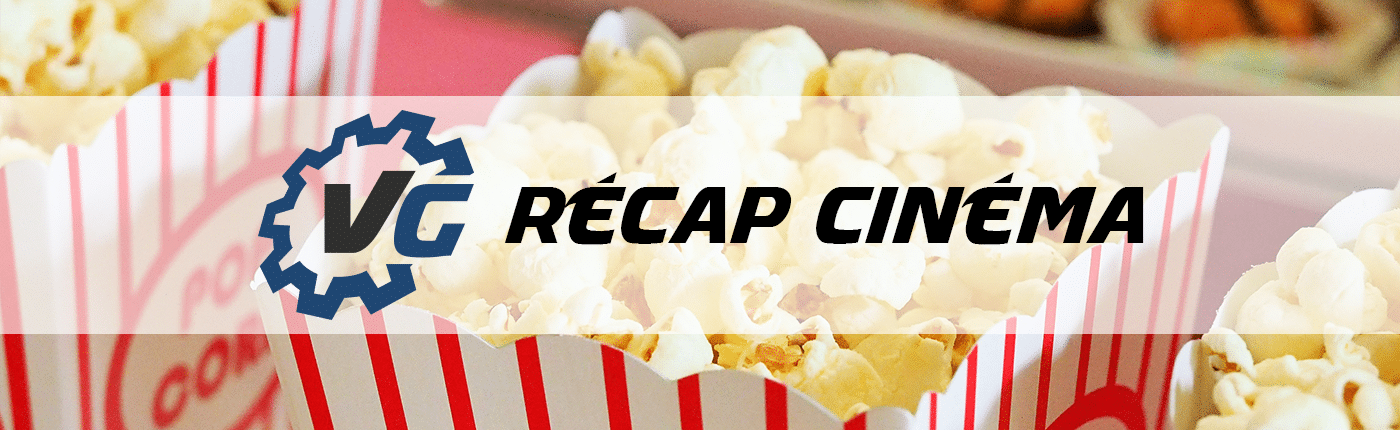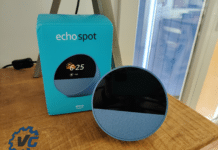Kingsman 2 : Le Cercle d’or, Lego Ninjago : Le Film, Detroit, La Passion van Gogh et Numéro Une : quels sont les films du moment à ne pas manquer ?
Kingsman 2 : Le Cercle d’or
Si Matthew Vaughn est parvenu à être si considéré, tant par les critiques que par les autres spectateurs, malgré un cinéma à première vue « populaire », c’est précisément qu’il s’est très vite emparé d’une forme américaine de blockbuster dont on pensait qu’elle avait perdu toute âme pour y ajouter une personnalité, une originalité, un quelque chose de curieusement premier degré et bad boy à la fois, comme une célébration par un adulte conscient et mûr des fantasmes adolescents les plus vulgaires et les plus ridicules. Un tel style court naturellement un risque, celui de se mordre la queue en se contentant de répéter des recettes, et ce n’est pas pour rien que Vaughn avait refusé de réaliser Kick-Ass 2 ou un autre film X-Men… avant de se lancer dans la suite de son Kingsman, officiellement parce qu’il avait pris tant de plaisir à réaliser le premier opus que jouir de la même liberté pour un deuxième lui paraissait irrésistible.
À sa manière décomplexée, il se débarrasse ainsi sans remords de ce qui aurait pu l’attacher au premier opus : dès le début du film, l’agence Kingsman n’existe plus qu’incarnée par Eggsy et Merlin, les autres chevaliers et leurs lieux emblématiques étant radicalement rayés de la carte, presque trop radicalement puisque devant l’étendue de la catastrophe, le spectateur n’est même plus touché par la disparition individuelle d’éléments qu’il avait pu apprécier… Du moins, entre cette séquence, celle d’une bagarre survoltée (et assez magistrale) dans une voiture, et un personnage passé au hachoir à viande et mangé sous forme de burger, l’absence de règles est claire, et on n’en attendait pas moins.
Eggsy et Merlin vont donc demander de l’aide à leurs confrères américains, les Statesman, qu’on pourrait d’ailleurs appeler les caméomen. Si vous avez vu la bande-annonce, vous avez dû imaginer les Statesman principalement incarnés par le formidable Channing Tatum, las, à la première occasion il est envoyé au réfrigérateur pour ne pas demander un cachet exorbitant, tandis que Halle Berry et Jeff Bridges sont d’une inutilité confondante, le film ne profitant même pas dans leurs quelques minutes à l’écran de leurs qualités d’acteur. On pourrait même malheureusement penser que Halle Berry n’est là que pour compenser le peu de diversité du casting, ce qui serait confirmé par le fait que, malgré son désir explicite de travailler sur le terrain, elle soit finalement promue sans avoir rien fait… On n’en apprécie heureusement que davantage l’excellente surprise fournie par Pedro « Oberyn Martell » Pascal, qui sera finalement le seul agent des Statesman que l’on verra en action, et qui vole sans difficulté la vedette à ses camarades, même à un Taron Egerton très investi et au bien-aimé Mark Strong.
La publicité autour du « casting 4 étoiles » en prend cependant un coup, alors qu’il s’agissait d’un des meilleurs arguments de vente d’un Kingsman qui nous promettait de jolis délires d’acteurs prestigieux, d’autant qu’Elton John apparaît juste un peu trop pour être tout à fait amusant, tandis que Julianne Moore apparaît trop peu pour être un antagoniste consistant – on croirait que Vaughn n’a même pas cherché à créer un vilain à la hauteur de Samuel L. Jackson. Et on touche là au problème central de Kingsman 2 : l’impression que l’équipe n’a pas vraiment essayé de frapper fort.
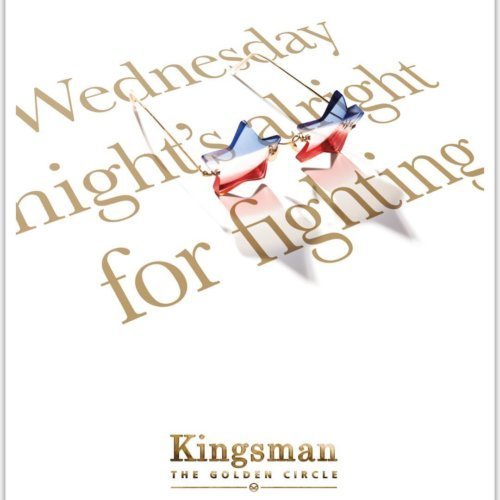
Quelques combats sont mémorables, mais même la bagarre finale, très dynamique dans son faux plan-séquence, ne peut rivaliser avec la scène de l’église ; le plan des deux méchants principaux ne cherche simplement pas à avoir de sens, l’un des deux étant d’ailleurs évacué avec une promptitude qui confine à la négligence ; et dans l’ensemble, l’histoire est cousue de fil blanc, d’un fil blanc qui croit qu’il peut se cacher sous l’action décérébrée et la vulgarité ambiante, et qui y parviendrait presque s’il n’était pas trop vraiment trop épais. Quand on prétend se ficher de tout, en tuant allègrement quelques personnages appréciés par le public sans vraie raison, et qu’on a besoin de faire revenir un personnage clairement mort pour faire plaisir aux fans, c’est qu’il y a un problème dans la cohérence du ton ; et quand on doit recourir à des ficelles aussi grosses que l’amnésie qui dure juste le temps qu’il faut pour arranger le scénario, ou du mail que la grande méchante envoie à tous ses agents avec ses coordonnées, toujours sans raison et au moment exact où les gentils en avaient besoin et ne possédaient plus aucune piste, on tombe dans la facilité caractérisée.
Alors bien sûr qu’on appréciera les audaces de langage et de situation d’un film globalement décomplexé, l’image grinçante qu’il donne d’un Président psychopathe, anticipant Trump et dans la continuité de certains discours hallucinants de Nixon ou Reagan, la petite réflexion bien sentie qu’il glisse sur la légalisation des drogues douces (ce qui est le seul objectif de Julianne Moore, merveilleux si seulement cela avait été fait avec finesse !), et surtout des scènes d’action soignées et saisissantes (qui ont d’ailleurs tant mangé de budget que toutes les autres scènes transpirent le fond vert), et tous ces éléments suffisent à faire de Kingsman 2 : Le Cercle d’or un film tout à fait recommandable à qui cherche à reposer agréablement son esprit, mais il est difficile de ne pas se dire que dans le scénario, dans le ton et même dans la satire et l’insolence, il y a dans ce film quelque chose de bâclé qui ne rend pas nécessairement optimiste quant à une suite déjà prévue.
Mise en scène : 7,5/10
Acteurs et interprétation : 7/10
Scénario : 5,5/10
Liberté : 7/10
Musique : 6,5/10
Verdict : 6,5/10 et une recommandation mitigée, Kingsman 2 : Le Cercle d’or étant principalement appréciable si l’on n’en attend pas trop, et surtout pas autant de plaisir que le premier avait pu en procurer. Pas seulement, comme on peut beaucoup l’entendre, parce que le premier était une surprise, simplement et surtout parce que le premier était réellement supérieur, dans son histoire, ses personnages, son ton (son dosage humour/insolence/vulgarité/drame), et son rythme.
Bonus (avec spoilers) : Comment Kingsman 2 aurait pu éviter la majeure partie de ses faiblesses et facilités scénaristiques
Sans même reprendre tout le film, tâchons de corriger les dernières séquences. Pour commencer, Merlin aurait dû mourir des mains de Poppy, d’une part parce que sa mort aurait été utile (plutôt que de servir à tuer six Jean-Jacques ayant bêtement quitté leur poste), d’autre part parce que cela aurait enfin donné quelque chose de menaçant à une super-vilaine qui n’a jamais tué personne de ses mains, et qui malgré tous ses moyens (d’ailleurs assez pauvres pour la plus grande baronne de la drogue du monde hein) peine à apparaître comme une antagoniste digne et charismatique. Ensuite, Ginger Ale (Halle Berry) aurait clairement dû intervenir in extremis, éventuellement en tuant Whiskey à un moment où les deux Galahad auraient été certains de leur défaite, cela aurait justifié qu’elle exprime plus tôt son désir de devenir agent de terrain tout en prouvant ses capacités, cela aurait enfin participé à un message un peu féministe (les femmes reléguées depuis le début du film à être les assistantes périphériques des hommes leur sauvent la mise) et expliqué pourquoi elle peut devenir agent des Statesman. Enfin, Eggsy et Harry auraient dû se rendre directement à la Maison Blanche pour arrêter le Président. Même dans une scène rushée, vous imaginez combien cela aurait pu être délicieusement too much, entre une éventuelle course-poursuite dans les couloirs et un bon coup asséné au bonhomme tout en diffusant l’enregistrement prouvant son plan diabolique ? Voilà une séquence qui aurait été drôle, aurait évité son arrestation ridiculement trop rapide (et son remplacement par une autre femme qui n’a servi à rien d’ailleurs), et aurait même montré au monde comment Eggsy a pu obtenir les médailles qui ornent son uniforme lors de son mariage, étant entendu qu’un agent secret ne reçoit jamais de distinctions publiques normalement, et qu’il ne les as clairement pas méritées dans sa vie civile… En ce qui me concerne, cela aurait suffi à sauver mon impression générale sur le film, et vous ?

Lego Ninjago : Le Film
Lego Ninjago est un film de la dernière chance pour la Warner : alors que La Grande Aventure Lego avait été une excellente surprise pour des spectateurs conquis par son rythme, ses capacités techniques, son avalanche de références pop destinées aussi bien aux enfants qu’aux plus grands, son histoire tenant parfaitement la route dans son délire assumé, et sa partie étonnamment émouvante, notamment dans le passage au live, Lego Batman avait beaucoup déçu, offrant un divertissement éparpillé et très enfantin. Ninjago partait donc très mal, et son projet d’adapter une gamme de Lego précise autour des ninjas, déjà portée sur le petit écran dans une série ciblant explicitement les plus jeunes, n’a pas contribué à donner confiance au public, et n’a pas fait apprécier le film à la critique.

Et effectivement, par quelques aspects, Lego Ninjago peut ressembler à la catastrophe prévue, en particulier dans la partie live qui entame et conclut le film, et qui montre un enfant marginalisé par ses camarades se réfugier dans un magasin d’antiquités tenu par un Chinois (Jackie Chan, aussi mauvais qu’il est apparemment convaincant dans The Foreigner), qui va tenter de le rassurer en lui racontant la vieille histoire des Ninjago (alors que l’histoire qui va suivre n’est pas plus une vieille histoire qu’elle ne peut être racontée par ce personnage). Affreusement mal réalisé, mal joué, et prévisible dans sa morale à deux sous, ce début pourrait faire quitter la salle à un spectateur, si les places ne coûtaient pas si cher de nos jours.
La partie Lego s’annonce un peu meilleure, ne serait-ce que par sa technique : le rendu des briques est impressionnant, et le film ne recule devant aucun effet de mise en scène pour épater le spectateur. Ainsi, il y a des décors que l’on ne voit que quelques secondes, ce qui force le respect quand on pense au temps qu’il faut pour modéliser chaque espace, et les « mouvements de caméra » sont exploités avec un réel sens du spectacle – même si des slo-mo et des chorégraphies à la Zhang Yimou auraient été un plus très apprécié. Et l’histoire part sur une prémisse amusante, l’histoire du jeune lycéen Lloyd, qui sous l’identité secrète du Ninja Vert doit sauver toutes les semaines la ville de Ninjago City des attaques répétées de son père, le seigneur du Mal Garmadon qui avait abandonné sa mère alors qu’elle venait d’accoucher.Si toute la ville connaît son ascendance et lui reproche donc injustement d’être responsable de ces assauts, elle admire le Ninja Vert, et seuls ses confrères ninjas connaissent sa double-identité.

Franchement, c’était prometteur, et il faut regretter amèrement que les réalisateurs n’aient même pas cherché à atteindre une cible adulte : alors que l’intrigue se prêtait à mille références pop, l’action se contente de clichés sans recul aucun et de plaisanteries ne faisant appel à aucune forme d’intelligence, s’assurant même, pour que la ribambelle de gamins de 3 ans comprenne bien les enjeux, de répéter cinquante fois l’élément auquel chaque ninja est associé. Et soudain, une fulgurance comique, l’« arme ultime » utilisée par Lloyd contre Garmadon, et qui provoque une catastrophe telle qu’il doit se mettre en quête de l’« arme ultime ultime » pour réparer son (hilarante) erreur, regagner l’estime de ses amis et de son vieux maître, et se découvrir lui-même, malgré la contrainte d’être accompagné par son père, seul être assez puissant pour lui permettre de surmonter les épreuves sur leur chemin malgré la menace qu’il fait peser sur le groupe.
Vous l’avez sans doute senti en lisant ce synopsis, on a comme l’impression qu’il y a deux histoires séparées dans ce Lego Ninjago, celle de la ville attaquée par le seigneur du mal et celle de la quête de soi dans une jungle périlleuse, et c’est une impression heureuse parce qu’il semble y avoir aussi deux scénaristes (en fait il y en a six, mais vous avez compris l’idée) : dans cette seconde partie, l’histoire sait exactement où elle va, rendant les péripéties plus intéressantes, les enjeux sont nettement plus clairs et on envisage mieux l’évolution de la relation père-fils qui s’esquisse. Dépouillé du bazar urbain, le film est à la fois plus amusant et plus sérieux, parvenant même à un flashback absolument superbe, tandis que la musique originale (très bonne) prend enfin le pas sur les emprunts « rock » assez médiocres.
Même si la fin revient aux inspirations premières, et paraît bâclée en même temps qu’assez décevante, empêchant clairement le film de satisfaire son ambition de concurrencer les Pixar, le pitch du film et la manière dont la deuxième partie est menée suffisent à placer Lego Ninjago bien au-dessus du tout-venant du cinéma d’animation pour enfants, et s’il faut regretter une inventivité humoristique et une pétillance assez pauvres en comparaison de Lego Batman, il faut en apprécier la linéarité, la volonté d’émouvoir et le travail de développement de personnages bien supérieurs.
Verdict : 6,75/10 et ma recommandation, si vous survivez aux blagues bas du front, à une morale piteusement retranscrite, et à une première partie très superficielle, vous serez arrivés à un degré de chi suffisant pour voir les beautés que Lego Ninjago a à proposer.
Et les autres ?
Recommandé : Étonnamment peu médiatisé, Detroit est pourtant le nouveau film de Kathryn Bigelow (Point Break, Démineurs, Zero Dark Thirty), l’une des réalisatrices les plus importantes et les plus frontales du moment, et un film qui ne démérité pas dans sa filmographie par son ambition de retracer les émeutes de Detroit en 1967 d’un point de vue général puis en se focalisant sur le micro-événement très révélateur de la tuerie de l’Algiers Motel. Un excès d’ambition peut-être, puisque l’absence admirable de réel protagoniste peut rendre l’expérience de ce film de 2 heures 20 assez longue à ceux qui espéraient plus de psychologie et donc plus d’occasions d’empathie, surtout quand on constate que Bigelow a préféré la photographie parfois hystérique de Barry Ackroyd (Démineurs, et collaborateur de Ken Loach et Paul Greengrass) à celle du remarquable Greig Fraser (Zero Dark Thirty, Lion, Rogue One, Bright Star…). Ceux qui pourront s’accrocher sortiront cependant de la salle avec la satisfaction d’avoir vu un film important, un peu plus trouble moralement que ce que ses personnages principaux pourraient laisser croire, et capable de tirer le meilleur en quelques scènes seulement de Jason Boyega (Finn dans la nouvelle trilogie Star Wars) et Anthony Mackie (Faucon dans les Avengers). Je regrette cependant qu’il commette une invraisemblance incroyable (en ce qui concerne le pistolet, vu par tout le monde et dont personne ne parle même quand cela les sauverait sans leur coûter…), qui ne manquera pas d’énerver franchement tout spectateur, peut-être tout au long du film…
Conseillé (mais pas indispensable) : Numéro Une a principalement deux défauts, celui d’être un film (après avoir été envisagé comme une série), et donc de condenser trop sommairement les enjeux déjà exposés magistralement dans Borgen, celui d’être une fiction, et donc de susciter souvent l’incrédulité d’un spectateur pour qui ces grands patrons qui ont tous des dossiers les uns sur les autres, complotent avec les Francs-maçons, sont en contact direct avec l’Élysée, et souffrent d’une misogynie maladive, ne peuvent être que des caricatures, là où les mêmes faits exposés sous la forme explicite d’un documentaire auraient été autrement plus frappants. Le premier défaut est sérieux, Numéro Une ne bénéficiant pas d’une direction artistique un tant soit peu remarquable, et sa plus-value venant donc essentiellement des interprétations d’Emmanuelle Devos, Benjamin Biolay et Sami Frey (particulièrement), ce qui lui confère un intérêt toujours insuffisant pour qui a regardé Borgen et a été porté par Sidse Babett Knudsen, Pilou Asbaek (eh oui, c’est de là que vient Euron Greyjoy !) ou Søren Malling… Le deuxième reproche est injuste, et c’est en le surmontant pour apprécier ce que Numéro Une révèle sur notre société que le film est le plus remarquable, si tant est qu’on soit prêt à l’entendre…
Conseillé : La Passion van Gogh est avant tout un film pédagogique : en saisissant le prétexte d’une lettre que Joseph Roulin (fils d’Armand Roulin, facteur et ami du peintre) doit apporter à Théo van Gogh, et de l’intérêt croissant qu’il porte au personnage de Vincent van Gogh et aux circonstances suspectes de sa mort, le film explore sous la forme d’une enquête le séjour du peintre à Auvers. Un mélange des genres bienvenu aussi bien pour rythmer l’intrigue que pour justifier l’interrogatoire successif des personnages, à la manière d’un walking simulator un peu rigide mais prenant, dont le principal intérêt n’est naturellement pas sa conclusion mais le travail graphique, puisque l’intégralité du film est réalisé en animant des tableaux de van Gogh ou en représentant des lieux et personnages dans son style. L’association de peinture à la main et de mouvements en 3D ou dus à la rotoscopie est ainsi extrêmement réussie, et rend le film incontournable pour les scolaires, à peine moins pour les amateurs du maître, et en tout cas digne de la curiosité de tout un chacun. Et petit bonus, vus reconnaîtrez probablement les traits d’un acteur de Games of Thrones chez un personnage récurrent !