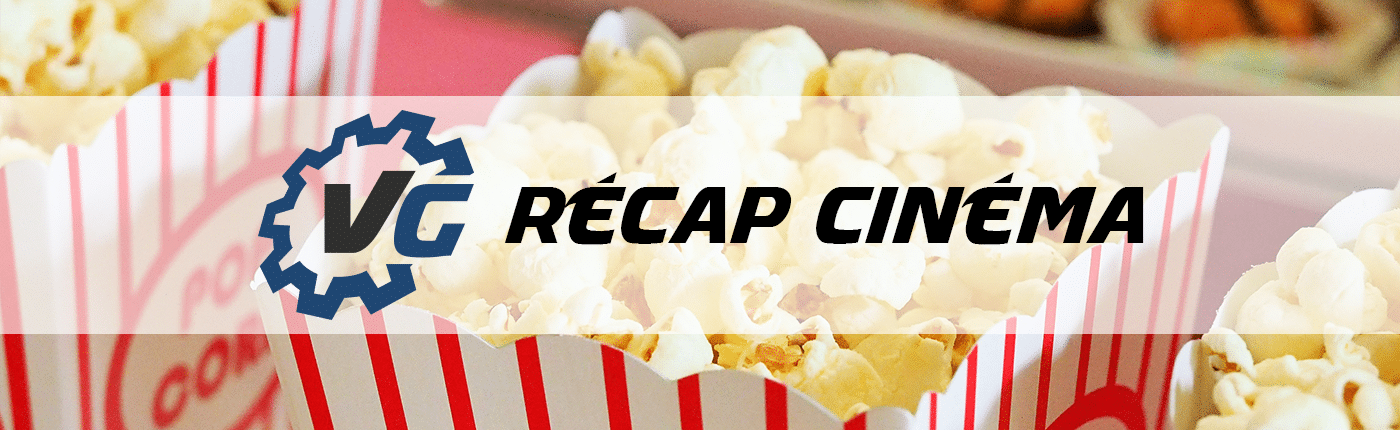A Beautiful Day (You were never really here) – critique à six mains et sans spoiler
L’affiche du film A Beautiful Day était alléchante : écrit et réalisé par Lynne Ramsay, avec Joaquin Phoenix en tête dans un rôle d’homme désabusé, brutal et violent, dans un film qui n’a en apparence rien à envier aux caractéristiques de son protagoniste principal. Vendu comme étant pas moins que le «Taxi Driver du 21ème siècle », A Beautiful Day a su déclencher une belle vague de hype autour de sa sortie. VonGuru n’a pas manqué cet événement et vous livre sa critique à six mains, garantie sans spoilers !
L’avis de Laurianne « Caduce » Angeon : ♫ si j’avais un marteau… ♫
A Beautiful Day – You Were Never Really Here – fait partie de ces films si prometteurs dans leur promotion et leur affiche que l’on se rend à la séance de cinéma fébrile, en attendant de recevoir le coup de poing, la claque cinématographique attendue. Je partais donc avec une réelle envie d’être surprise, tenue en haleine, malmenée par le récit violent de A Beautiful Day, et j’en suis pourtant ressortie en demie-teinte, à la fois convaincue de ne pas avoir vu un mauvais film, et déçue de ne pas avoir vu plus que cela malgré tout.
A Beautiful Day promettait pourtant un certain nombre de choses alléchantes : tout d’abord, et il serait injuste de ne pas le citer, un Joaquin Phoenix en grande forme dans un rôle puissant. Toujours un plaisir donc, de voir et de redécouvrir un acteur aussi talentueux poussé dans divers retranchements artistiques. L’ambiance ensuite, résolument annoncée comme violente et implacable, pour un film coup de poing et sans concessions, qui plus est réalisé par la talentueuse Lynne Ramsay (une patte de femme dans cet univers brut était d’ailleurs aussi parmi ces éléments si prometteurs).

Si l’on reprend dans l’ordre donc, Joaquin Phoenix livre tout d’abord une prestation magistrale, et il est sans doute LA grande réussite de ce film, l’élément central qui le porte à bout de bras, dans un rôle aussi puissant que nuancé dans son attitude, avec une humanité particulièrement authentique et discrète émanant à de nombreuses reprises dans l’aura du personnage. Pour ce qui est ensuite de cette ambiance, cet esthétisme, qui était à vrai dire le point fort attendu, lorsque l’on parlait de A Beautiful Day comme d’un Drive-like, mélange de Taxi Driver ou d’influences Park-Chan wookiesques, les choses ont dégénéré et c’est précisément là que le film s’égare. Car You were never really here n’aura à aucun moment la force et les arguments de sa prétention (en dehors d’un début magnétique et de quelques scènes irréprochables) en ne parvenant jamais à égaler ses prédécesseurs, ni dans la densité de l’ambiance, ni dans l’esthétisme, qu’hélas une intrigue bien trop simpliste ne suffira pas à sauver. Le contraire eut été un coup de maître, en proposant ainsi un synopsis simplissime, dont la seule ambiance aurait suffi à sublimer le tout. Dommage. Pourtant, il serait vraiment cruel de dénigrer en tout point A Beautiful Day, qui œuvre pour proposer un « divertissement », un coup de sang cinématographique bref et saisissant (1h25 de film). En premier lieu, le rendu sonore du film, qui en plus de la prestation de Phoenix, distille en continu ce sentiment d’oppression et de malaise. Avec une parfaite maîtrise de sons sur-saturés, de silences glaçants, de bruits anodins mis sur le devant de la scène, A Beautiful Day puise la puissance (toute relative comme nous l’avons dit) de son ambiance dans le son. Or, en termes d’image, si la violence de aBD est loin d’être simple et s’avère plutôt intéressante dans son traitement (images hors-plan, ellipses, brutalité, froideur…), elle n’égale en rien le niveau que suggérait l’OST du film, haletante et entraînante à souhait. Le film n’innove donc ni dans son intrigue, ni dans son aspect brutal d’un point de vue dramatique, violent et visuel, bien qu’il tente d’en esquisser quelques contours prometteurs. Quitte à proposer un film atypique et brutal, un parti-pris davantage transgressif aurait été le bienvenu : il aurait probablement divisé mais aurait probablement créé un réel engouement.
Qu’il est alors difficile de « descendre » A Beautiful Day, tant son accroche paraissait sublime de sauvagerie. D’autant plus que Lynne Ramsay sait surprendre, sait réaliser et a déjà démontré son talent, sans artifices. Si A Beautiful Day aurait pu être son nouveau grand film, il n’en ressort qu’une pâle tentative d’imiter les meilleurs du genre, et avec toute la bonne volonté du monde, cela reste dur à admettre. Si Joaquin Phoenix, n’avait pas été là, nous n’aurions pas donné cher du long-métrage, et c’est tout à fait regrettable.
L’avis de Siegfried « Moyocoyani » Würtz : le croisement décevant de Logan et de Taxi Driver (mais évidemment, il est plus classe de ne mentionner que Taxi Driver)
Un nouveau film doit apporter quelque chose d’un peu neuf. C’est une opinion contestable sans doute, mais que je pense aussi relativement partagée, et le visionnage de You were never really here m’a inspiré le besoin de commencer la présentation de mon avis par cette phrase, précisément parce que je peine à voir quel intérêt il croit avoir dans le paysage cinématographique.
Si je vous parle d’un vieux briscard, ayant perdu pratiquement tous ses proches et qu’une vie de violences et d’isolement a rendu plus violent encore, désabusé et cynique, décidant de faire un baroud d’honneur quand la dernière personne à laquelle il est attaché est menacée par des forces para-gouvernementales surarmées, s’attachant malgré tout à une petite fille également sans pitié malgré une façade innocente, et pour laquelle il risquera tout, vous aurez le synopsis aussi bien de You were never really here que de Logan. Mais évidemment on pourrait jouer à ce jeu-là plus ou moins longuement avec bien d’autres films, comme celui auquel on a tant comparé le Ramsay, l’histoire d’un ancien militaire dégoûté par le monde, déçu par un homme politique qu’il cherche à tuer, se jetant à bras ouverts dans la violence pour sauver une fille de douze ans d’une vie de de sévices sexuels. C’est Taxi Driver, et You were never really here est à peine moins nourri de The Driver et Drive, de No Country for old Men (qu’il cite même une fois) et du triptyque de la vengeance de Park Chan-wook (qui justement était membre du jury à Cannes, tiens tiens…).

Cela ne saurait suffire à condamner You were never really here, puisqu’on peut remaker et recourir à tous les stéréotypes possibles tout en réalisant un chef-d’œuvre, pourtant de la part d’un film annoncé partout comme une claque, l’incapacité à susciter de la première minute à la dernière la moindre surprise narrative est regrettable, surtout quand tous ses modèles avaient une originalité scénaristique, parfois même une audace politique ou un talent sordide pour la provocation dont leur successeur est absolument dépourvu. Johnny Greenwood (de Radiohead) a beau livrer une bande originale très prenante, évoquant Drive sans démériter, arrive un stade où la musique (a fortiori de l’électro minimaliste) doit soutenir un propos cinématographique… Il faudra bien sûr apprécier la finesse avec laquelle on suggère le passé du personnage principal, par des flashs plus proches de la sensation sonore et visuelle que d’un traditionnel flash-back, ou le degré de corruption des antagonistes, tout en convenant que ce sont des « nouveautés » bien relatives.
Pourtant, You were never really there a reçu un Prix du scénario. Naturellement, un « scénario » ce n’est pas qu’une intrigue, même pas que des dialogues, et il pourrait tenir sur un timbre-poste sans l’empêcher d’être unanimement loué – et il est très heureux que la sobriété et l’économie soient aussi valorisés que la labyrinthique et l’expansion lexicale à la limite du bavardage. Malgré tout, ce qui a pu justifier ce prix demeure assez vague, et il est très probable qu’il récompense la manière dont l’évolution de l’histoire est structurée et mise en scène, c’est-à-dire le montage effectivement extraordinaire du film à l’échelle des plans et des scènes. Les prix qui auraient pu récompenser Lynne Ramsay comme réalisatrice ayant déjà été attribués à d’autres films qui les méritaient admirablement (120 Battements par minute, Les Proies, Faute d’amour), le jury se serait ainsi rabattu sur ce prix pour la récompenser au moins en tant que scénariste, ex-aequo avec Mise à mort du cerf sacré pour atténuer encore le scandale, sachant que le film de Lanthimos aurait lui-même mérité un prix pour sa mise en scène (en plus de celui pour le scénario pour le coup).
Pour le prix d’interprétation masculine en revanche, Joaquin Phoenix était une évidence. Non seulement parce que c’est un point sur lequel la compétition cette année était un peu faible (Garrel et Lindon n’auront qu’à se battre pour le César), surtout parce qu’il livre une prestation auto-destructrice indéniablement fascinante, qui rappelle enfin à quel point il est bon acteur, et s’ajoute donc à ses performances les plus marquantes, celles dans Gladiator, Two Lovers, I’m still here, The Master, Her et Inherent Vice, dans une moindre mesure Walk the Line, en attendant son interprétation de… Jésus pour Garth Davis l’an prochain. Il n’a pas seulement développé sa musculature, il parvient à faire ressentir sa fragilité physique tout en s’imposant par son invulnérabilité, dépassant le simple stéréotype de la brute-nounours pour jouer sur une frontière plus paradoxale, et faisant en cela mieux que Jackman dont le jeu dans Logan était aussi fin mais n’était pas aussi constamment en équilibre. You were never really there est pratiquement plus un film sur et pour Joaquin Phenix qu’autre chose, ce qui expliquerait d’ailleurs que son titre soit un écho si explicite à l’auto-mockumentaire (oui, c’est compliqué) I’m still here, où Casey Affleck racontait l’absurde tentative par son frère de revenir sur le devant de la scène après avoir traversé un désert artistique…

Le choix de l’acteur s’inscrit donc parfaitement dans l’évolution du cinéma de Lynne Ramsay, qui tend progressivement à l’abstraction émotionnelle, s’éloignant de l’intimité humaine pour un choc tenant davantage de l’esthétique. Le début de You were never really here est ainsi d’une virtuosité impressionnante, chaque plan étant pétri de sens et de beauté, et le film brillant dans sa monstration de la violence, d’abord directe, puis hors champ, puis simplement coupée, avec une véritable élégance dans la complaisance. Le problème étant que, quand on définit des standards élevés, que l’on place d’emblée la barre aussi haut, on ne peut plus se permettre par la suite de démériter, et si de vraies intuitions de mise en scène continuent d’affluer (Ramsay est une grande cinéaste), les images plus banales se multiplient aussi, chacune cassant la continuité esthétique créée. J’aime énormément le parti-pris de ne suivre que le personnage, la caméra mimant sa vision, le suivant de dos ou le montrant frontalement, ce qui contribue considérablement à justifier le minimalisme du film. Or d’une part Ramsay s’écarte de temps à autre de ce parti-pris sans vraie raison (je pense notamment à une conversation téléphonique), d’autre part elle cède parfois à la banalité quand l’intensité visuelle de certaines scènes prouve sa capacité à exprimer une radicalité sur un temps long, radicalité qui aurait pu apporter une singularité définitive au film.
J’étais conquis d’avance et dans les premières scènes par l’ultra-violence sophistiquée de You were never really here, mais je suis décidément amer de n’y trouver ni la force du sujet ni la qualité constante de We need to talk about Kevin (ou même l’intérêt narratif de Morvern Callar voire de Ratcatcher). Quand on pense que Ramsay aurait dû réaliser Lovely Bones à la place de Peter Jackson, on sent qu’on est passé à côté d’un grand film, où elle aurait pu mettre sa puissance au service d’un récit, et nous imposer les images inédites qu’elle est parfaitement capable de produire, plutôt que de montrer qu’une femme était capable de s’emparer d’un genre si masculin, oubliant tout ce que les films qu’elle imite avaient de séminal. S’il n’y avait pas Joaquin Phoenix, You were never really here laisserait apparaître plus vite l’amoncellement de clichés sur lequel il est bâti, il sombrerait assez vite, et j’en suis vraiment le premier déçu…
Petit bonus, le très beau court-métrage Swimmer de la même Lynne Ramsay :
L’avis de Mathilde « Shai » Leroy : relativité de la Violence
Aller voir A Beautiful Day était une décision simple : après 10 secondes à regarder les images du trailer défiler sous mes yeux, il était évident que je tenais là un successeur potentiel à Drive en terme d’ultra-violence dramatique, le charisme calme et sexy de Ryan en moins (que j’ai adoré dans le tout récent Blade Runner 2049), le charisme énervé et viril de Joaquin en plus (que j’ai adoré – en version moins véner’ quand même – dans le moins récent Her). Verdict après une heure et demie en salle obscure !
La première chose qui impressionne dans A Beautiful Day est la capacité de la réalisatrice à nous mettre dans la peau de son protagoniste, Joe, un vétéran coriace et complètement paumé qui joint les deux bouts en assurant quelques jobs glauques style « chasse aux kidnappeurs de mineurs ». Cette immersion du spectateur se fait assez naturellement, un peu comme si nous prenions possession de la vue et de l’ouïe de Joe : la caméra ne le quitte jamais (à l’exception d’une scène ou deux), le son (bien plus son que musique, pour l’occasion) est une restitution très fidèle, tant de la réalité (les chaussures qui font pouic-pouic quand Joe sort de sa – triste – baignade, pour ne citer que cet exemple) que de ses hallucinations et états d’âme, par une saturation presque insoutenable de la bande-son… Premier constat : A Beautiful Day est un film dur, non pas seulement pour sa violence, mais surtout parce que la réalisatrice en a fait un film qui vous prend aux tripes, et joue avec votre rythme cardiaque sans aucune pitié !
Au delà de son côté viscéral, la représentation de la violence est très particulière. En effet, si le film est un réel déchaînement de violence brute, la caméra quitte régulièrement la proximité immédiate de notre forcené pour patienter quelques instants, le temps que les cadavres s’amoncellent hors-cadre, avant de constater les conséquences de la violence plutôt qu’un témoignage immédiat. Procédé analogue d’adoucissement de la violence : certains meurtres sont proposés sans aucun son, depuis l’image en noir & blanc d’une caméra de surveillance à l’angle bien choisi. Ce contraste entre un déferlement de violence psychologique (les flash-backs de Joe sont intégrés au film d’une manière assez forte) et une violence très gore mais pourtant minimisée est une des forces du film, un peu comme si, par cette mise en perspective de la fureur de notre anti-héros de son point de vue, la légitimité de ses actes sanguinaires s’en trouvait renforcée, avant même de nous soucier des enjeux scénaristiques. Je souffre très fort donc je tue, mais pas trop fort.

Dernier point, le scénario. Si l’intrigue de A Beautiful Day peut tenir sur un timbre-poste (en écrivant petit quand même), le film n’en souffre pourtant pas tant que ça. À l’instar de Drive, A Beautiful Day est un film d’ambiance, et le scénario n’est qu’un prétexte pour installer un cadre, un contexte à la descente aux enfers d’un homme qui n’était déjà pas au top. Ma conclusion sera simple : si vous avez aimé Drive (notamment la dernière partie), si vous avez envie d’un film qui vous remue ou si les marteaux vous passionnent, foncez. Une seule chose, n’emmenez pas vos enfants.