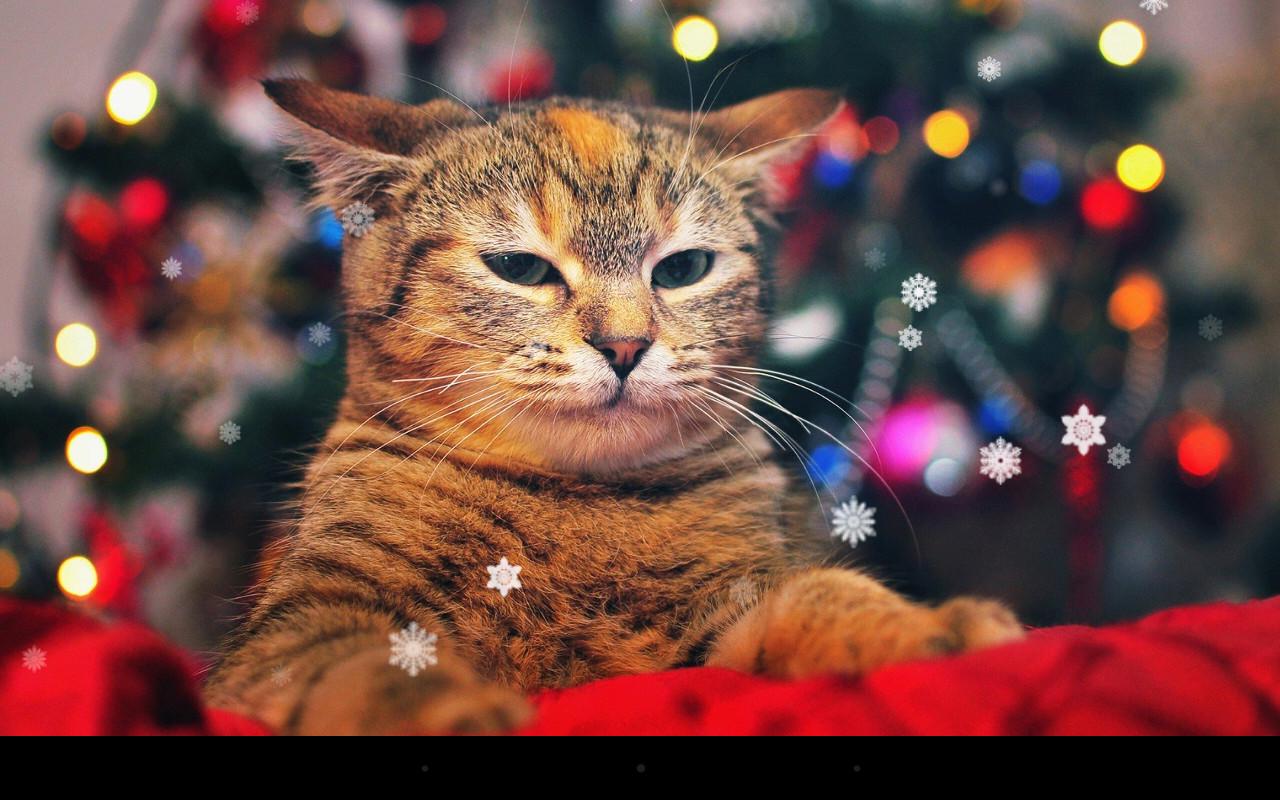Assassin’s Creed : enfin une bonne adaptation de jeu vidéo ?
Si, chez VonGuru, nous attendions tant Assassin’s Creed, ce n’était pas seulement pour la curiosité de voir porter sur le grand écran l’une des sagas importantes de l’histoire du dixième art, marquante pour tous ceux qui y jouèrent avant qu’ils ne se lassent de sa répétitivité. C’est avant tout que le film Assassin’s Creed signifie autant, quelle que soit sa qualité, pour les gamers que pour les cinéphiles : de son succès dépend un flot d’adaptations que tous les studios promettent depuis des années mais ne réalisent jamais, attendant qu’un concurrent prenne le risque de sortir un cobaye qui pourra rassurer l’industrie.
Les adaptations passées, après un âge sombre qui culmina avec les accidents d’Uwe Boll, ne revêtaient pas d’enjeux aussi importants : si les mésaventures de Ratchet et Clank ont découragé les studios d’adapter Sly Cooper, c’est qu’il peinait à convaincre comme film d’animation, tout à fait indépendamment de ses qualités de portage de jeu, Angry Birds mérite à peine d’être mentionné, tandis que Warcraft inaugurait les tentatives de rendre les adaptations de jeu vidéo sérieuses, tout en cherchant à prouver qu’un univers fantasy et bariolé pouvait être tragique.
Assassin’s Creed présente un cas différent, un peu plus qu’une simple étape supplémentaire : cette histoire de guerre millénaire entre Assassins et Templiers a pour champ de bataille les soubassements fictifs de notre Histoire, et pour fondement la lutte on ne peut plus actuelle entre les tenants d’une liberté absolue et ceux d’un bonheur contrôlé. L’intrigue est donc très humaine, à peine mâtinée de science-fiction (on accepte bien pire du cinéma qu’un appareil permettant de revivre l’histoire de ses ancêtres) et de fantastique, et surtout très sérieuse.
Ce n’est ainsi pas pour rien que Ubisoft en confia les rênes à deux personnalités déclarant à chaque interview qu’elles ne sont pas des gamers et n’avaient jamais touché aux jeux Assassin’s Creed avant de se lancer dans son adaptation, le réalisateur australien Justin Kurzel et celui qui le proposa, l’acteur (et producteur exécutif) Michael Fassbender. Un réalisateur connu pour la froideur et la crudité de ses films, et l’un des plus dignes héritiers de DiCaprio, pour une saga au potentiel philosophie et cinématographique puissant… Malgré les réticences exprimées dans ma hype review, il aurait été impensable de ne pas laisser toutes ses chances à Assassin’s Creed – le film !
Assassin’s Creed : Black Flag
Soyons francs, je m’attendais au pire. De la filmographie de Kurzel je n’avais guère apprécié que les dix dernières minutes sidérantes de Macbeth, après une heure quarante de creuse sophistication visuelle à la limite du ridicule, ce film comme son précédent, Les Crimes de Snowtown, recherchant une froideur qui me glaça parfois et m’ennuya souvent. Et je doutais qu’il parvienne à conférer un même souffle épique aux combats d’Assassin’s Creed qu’à une adaptation shakespearienne. Difficile par ailleurs de ne pas lui reprocher d’avoir préféré placer son frère Jed Kurzel à la composition au lieu de Jesper Kyd, d’abord annoncé, et auteur des thèmes les plus marquants des jeux. Enfin, la musique de certaines bande-annonces me paraissait vulgairement tapageuse, sans lien aucun avec les images montrées, tandis que la mention de la pomme d’Eden dans la dernière achevait de me convaincre que les auteurs du film avaient cédé aux sirènes du kitsch. Comment en effet prétendre au sérieux et évoquer dès le premier film ces artefacts provenant d’une civilisation antiques presque divine et aux pouvoirs parfaitement surnaturels ?
Si vous avez lu d’autres critiques, vous devez estimer que ces craintes sont confirmées, ou qu’au contraire Assassin’s Creed n’est (de l’aveu du directeur Europe/Asie d’Ubisoft Alain Corre) qu’un pur produit marketing destiné à mieux vendre les jeux, une publicité sans âme.
De fait, cela commençait on ne peut plus mal dans les trois débuts du film. Dans l’Andalousie de 1492, on nous explique (sur une très mauvaise musique) que la mission d’Aguilar est de sauver le prince Ahmed, fils du sultan de Grenade et gardien du Credo des Assassins, que les Templiers cherchent à échanger auprès de son Père contre la Pomme d’Éden. Les efforts de reconstitution dans les costumes et décors sont ainsi diminués par l’absence de scrupule historique d’un film qui invente une stupide histoire d’échange de fils et d’artefact dont jamais l’origine ni les pouvoirs ne nous seront dévoilés, au point (si je ne me trompe pas) qu’il ne se soucie même pas de nous donner une seule fois le nom du nasride de Grenade, Mohammed XII dit Boabdil, là où les jeux, dans toute la latitude permise par le médium, témoignaient d’un désir exemplaire de partager l’histoire. Le second début nous montre Callum enfant s’entraînant au cyclo-cross et découvrant l’assassinat de sa mère par son père, et le troisième l’injection létale supposée punir Callum adulte du vague assassinat d’un proxénète.
Ces trois commencements ont en commun d’être totalement inintéressants. Il est difficile de déterminer si Justin Kurzel ne sait pas créer une identification avec ses personnages ou s’il est dans une démarche volontaire de distanciation émotionnelle, dans tous les cas on ne ressent aucune empathie pour ce personnage assez plat, d’une pauvreté sentimentale affligeante, ni pour aucun autre, en particulier le love interest d’Aguilar, faute d’approfondissement biographique et psychologique, ce qui est naturellement gênant dans des scènes de mises en danger qui ne peuvent qu’indifférer le spectateur.
Ainsi, les premiers combats et les séquences de parkour sont à peine regardables. Quelques sauts de toit en toit sont encore assez jolis, mais la plupart de ces images sont tellement sur-cutées que l’on ne ressent pas plus de tension que d’admiration pour le caractère badass des Assassins. Ce montage frénétique tendant vers l’illisible va à l’encontre des efforts chromatiques de Kurzel, son soin de séparer chromatiquement passé et présent devenant vite un défaut quand à chaque seconde il saute d’une époque à l’autre. On ne demande qu’à croire l’équipe technique quand elle affirme que la plupart des actions ont été tournées sans numérique, y compris des sauts de la foi effectués à une hauteur de 38 mètres pour une vitesse de chute atteignant les 98 kilomètres/heure. Mais cet effort était parfaitement vain si on ne peut pas l’admirer dans un plan-séquence : un saut de la foi en trois plans apparaît immanquablement comme un trucage…

Or les seuls plans-séquences accompagnent un aigle à l’occasion des entrées de Callum dans l’animus, du fan-service assez dommageable puisque la fausseté de l’aigle numérique se conjugue avec des paysages banals, un seul de ces longs plans aériens étant impressionnant, celui survolant une foule en guerre, preuve que Kurzel n’ignore pas la puissance dynamique d’un plan-séquence bien employé… Dans l’ensemble, il est difficile de dire qu’il soit parvenu à transposer des éléments d’une esthétique du jeu vidéo dans son film, les moments les plus vidéoludiques (l’aigle, le tir d’une flèche en vue à la première personne, certains sauts rappelant le TPS,…) pêchant justement par excès d’imitation, au point d’être je pense reconnaissables comme des éléments de jeu même par des non-joueurs tant ils jurent avec l’esthétique globale du film.
Vers un Assassin’s Creed Cinematic Universe ?
Par contre, les trois scénaristes (visiblement des complets inconnus) n’ont reculé devant aucune incohérence ou facilité dramatique, comme si le fait qu’il s’agisse à la base d’un jeu vidéo permettait tout. Par exemple dans le fait que les héros puissent courir sur les toits avec une agilité remarquable…et que pourtant ils rencontrent toujours devant eux des soldats ennemis qui les attendent, voire des adversaires qui étaient clairement en arrière, comme dans un de ces jeux à l’IA détestable où le monde entier vous poursuit dès que vous êtes repéré sans avoir aucune possibilité humaine de savoir ce qu’ils vous reprochent. Ou le fait que Callum réalise des prouesses athlétiques alors qu’il n’a jamais reçu d’entraînement d’assassin et que l’on n’évoque absolument jamais son passé, y compris d’un point de vue sportif/militaire. Ou encore la vision qu’ont les scientifiques d’Abstergo de ce que voit Callum dans l’animus…
Sans parler de la Pomme d’Éden : cet artefact des temps anciens et à la forme exacte d’une boule de pétanque contiendrait « les germes de la désobéissance originelle » (d’où son nom) et donc le moyen de mettre fin au libre-arbitre, deux notions que l’on peine à imaginer concrètement contenues dans un objet, même magique. Les joueurs ont vu l’effet des Pommes d’Éden (parce qu’il y en a plusieurs), en particulier dans le premier opus où un personnage s’en servait pour perturber notre esprit, créer des illusions et contrôler des êtres, mais le film ne détaille jamais ces pouvoirs pour les non-initiés, et il semble même que ceux qui la détiennent ne l’essayent jamais, lui attribuant ces propriétés exemplairement vagues et la cherchant impitoyablement sans être plus curieux…

On sent que les scénaristes ont été gênés avec cet objet bien trop « jeu vidéo » pour convaincre le spectateur lambda, d’où sa fonction de MacGuffin plutôt que de réel instrument dans le film, et il est regrettable qu’ils n’aient pas plutôt cherché soit à s’en débarrasser soit à faire le pari d’en simplifier les usages ou de nous les expliquer posément afin d’obtenir notre suspension consentie d’incrédulité…
D’autant que les gamers ne peuvent avoir aucune certitude : Ubisoft a visiblement fait le choix très curieux de situer le film dans une continuité différente de celle des jeux vidéos, puisqu’Abstergo n’y développe qu’un Animus, projet personnel de la scientifique incarnée par Marion Cotillard, que l’entreprise est même menacée de ne plus être financée par les Templiers en raison de son inefficacité (et on se demande effectivement ce qu’ils font en dehors de l’animus)… Il est incompréhensible que l’équipe créative n’ait pas cherché à proposer une histoire parallèle qui aurait été un complément aux jeux vidéo, soit en présentant de manière indépendante une autre quête et un autre personnage, soit en développant des thèmes déjà introduits dans les jeux ou en en introduisant d’autres pour les jeux suivants, le film était bien pensé comme notre dose d’Assassin’s Creed après une éternité sans nouveau jeu…
Tous les jeux formaient une continuité unique, pourquoi en créer une nouvelle dans ce qui devrait être une saga cinématographique ? Ubisoft ne risque-t-il pas de perdre les joueurs, en leur livrant un film esthétiquement assez mature (dans sa colorimétrie hein, pas dans sa violence, Ubisoft ayant réussi l’impensable en proposant un film sur des assassins sans une seule goutte de sang), et en l’inscrivant dans une continuité différente ?
De l’ombre naît la lumière
Calamité dans sa première demi-heure, Assassin’s Creed est parvenu à me faire sortir de la salle en espérant qu’une suite serait produite, et que la même équipe en aurait la responsabilité – ce qui est peu probable, Ubisoft ne pouvant que regretter des choix audacieux aussi peu payants en terme de critiques.
Il n’y a pas (malheureusement) de révolution soudaine dans le film, mais certaines qualités finissent par retenir l’attention, et sont développées de manière assez intéressante pour que l’on sente plus d’authenticité de la part de Kurzel et de ses acteurs que ce que l’on pourrait croire d’abord. Le casting est évidemment impressionnant, voire improbable pour un film pareil : Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Charlotte Rampling… Ces acteurs sont étonnamment investis dans leurs rôles, et semblent tellement se prendre au sérieux qu’on peut éprouver le désir de les voir davantage. Il est regrettable que les deux têtes d’affiche souffrent l’un d’une absence de réelle caractérisation, l’autre de l’inexistence de séquences exigeant un jeu plus expressif et intense, parce qu’ils semblent se faire à ces personnages si différents de ceux qu’ils cherchent à incarner habituellement.

Cotillard surtout pourrait être le rôle principal tant il est évident que les scénaristes ont reporté sur elle le peu d’inspiration que leur suscitait Callum. Jusqu’à la toute fin (où elle devient soudain médiocre, en écriture et en jeu), on se surprend à se poser des questions sur son devenir, sur la sincérité de ses idées, sur son réel positionnement dans la lutte entre Templiers et Assassins, et elle forme en cela avec Fassbender d’une part, avec Irons de l’autre, des duos qui ne sont pas si loin de fonctionner à l’écran.

J’avais mentionné les dix dernières minutes de Macbeth : Kurzel s’efforce manifestement d’en recréer l’intensité et la beauté incroyables dans le combat du climax, qui sans arriver aux mêmes hauteurs est d’une indéniable grâce. Dynamique et magistral, il captive le spectateur en tranchant avec les affrontements précédents…et avec un autre affrontement, montré en séquences alternées, et d’un manque de maestria inconcevable, notamment lié au désintérêt total que nous pouvons avoir pour l’un ou l’autre camp, à un moment où Callum obtient presque une profondeur. Soudain, la colorimétrie ocre qui caractérisait le passé et les effets constants de poussière, assez gratuits, trouvent une pleine justification, et le réalisateur rappelle qu’il n’est pas (qu’)un mauvais faiseur se prenant pour un auteur, mais qu’il possède une personnalité artistique qu’il peine simplement à exprimer pleinement, peut-être dépassé par les exigences d’un film si différent de ses productions habituelles.
La progression du film (dans le temps et la qualité) est naturellement aidée par une musique bien rythmée et très bien montée sur les images, malgré l’absence de thèmes vraiment marquants, et par le développement dans les dialogues des idées centrales de la saga Assassin’s Creed. Même si l’on continue de ne pas bien comprendre, au fond, ce qui oppose les deux confréries, et que le film ne dépasse pas le stade réflexif globalement plat des jeux (très étonnant dans les premiers, puis incapable d’ajouter quoi que ce soit), certaines scènes parviennent à être discursives sans virer au monologue et à livrer dans un bel emballage rhétorique (portés par la voix de Jeremy Irons quand même !) un faux éloge de la société de consommation comme outil d’assujettissement par l’abrutissement d’une population oubliant la liberté pour ne plus cultiver que le bien-être. Pas subtil, mais pas attendu non plus.

Le saut de la foi
Dans sa globalité, Assassin’s Creed ne convainc pas aussi bien que Warcraft, qui était plus homogène et mieux ficelé. À ne regarder que les qualités, le film d’Ubisoft est cependant plus impressionnant dans sa capacité à rassurer sur la qualité des adaptations de licences vidéoludiques. S’il a certes été rentabilisé, il est cependant indispensable que le studio comprenne dans le détail ce qui fonctionnait et ce qui doit absolument être revu en profondeur : rien ne serait plus dommageable qu’un abandon de la saga (comme Blizzard semble avoir abandonné Warcraft ?) ou qu’un revirement scénaristique et esthétique complet (comme le massacre opéré par la Warner sur les films DC), et peu de films pourraient mieux nous rassurer sur l’avenir du blockbuster en général qu’une suite cohérente dans l’ambition, plus émouvante et plus dynamique, mais constante dans sa beauté et sa compréhension de l’histoire adaptée.