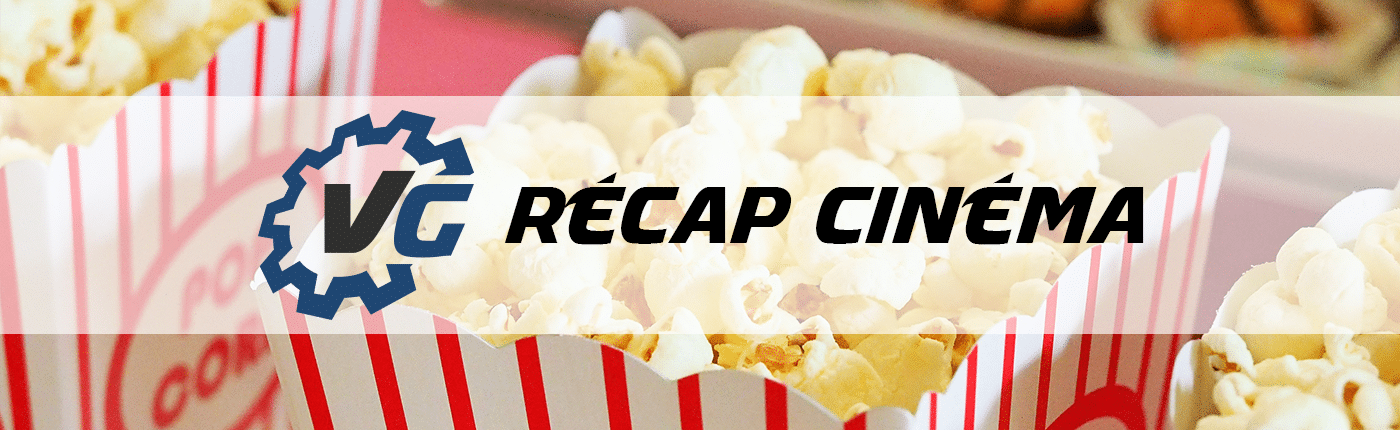Hype Review # 2 – High-Rise
Bonjour et bienvenue dans Hype Review, la nouvelle publication irrégulière de Cleek dans laquelle il s’agira de commenter un film…avant sa sortie. Bandes-annonces, casting, filmographie de l’équipe technique, influences, tout y passera, afin de juger du degré légitime de hype suscité par le long-métrage en question, en essayant de pré-juger de sa qualité, mais toujours dans l’espoir qu’il finisse malgré tout par nous surprendre et surpasser toutes nos attentes !
Après un premier article consacré au Batman v Superman : Dawn of Justice de Zack Snyder, nous nous pencherons aujourd’hui sur un autre de nos films les plus attendus de 2016, le High-Rise de Ben Wheatley, qui sortira le 6 avril prochain, après avoir été projeté au festival de Toronto le 13 septembre 2015.

[divider]Au commencement était la lettre[/divider]
Une fois n’est pas coutume, Ben Wheatley, qui ne s’est pourtant jamais appuyé que sur des scénarios originaux écrits avec son épouse, a décidé pour ce nouveau projet d’adapter un roman éponyme, High-Rise de J.G. Ballard. Bien qu’il soit considéré comme l’un des grands auteurs de science-fiction du siècle dernier, les deux films inspirés de son oeuvre sont étrangers à ce genre, et sans nécessairement en connaître l’origine textuelle, les titres vous en sont sans doute connus, puisqu’il ne s’agit pas moins que d’Empire of the Sun de Steven Spielberg et du Crash de David Cronenberg.
High Rise ne participe pas non plus de son talent pour la création d’univers apocalyptiques et post-apocalyptiques, mais cette dystopie fait clairement, dans sa critique du système capitaliste, le lien entre le pan « contemporain » de son oeuvre, par exemple illustré par Crash, où il était question de l’excitation sexuelle engendrée par les accidents de voiture, et les univers de fin du monde qui en caractérisent l’autre pan. L’essentiel des romans et nouvelles de l’écrivain britannique trouve ainsi son homogénéité comme « dystopie moderniste qui passe par la représentation des paysages mornes conçus par l’homme et des effets psychologiques des développements technologiques, sociaux et environnementaux.», ainsi que le résume efficacement le Collins English Dictionary.
Sans appartenir à ses œuvres les plus connues, High-Rise est donc typiquement ballardien, puisque toute l’action en est située dans un Immeuble de Grande Hauteur (I.G.H., qui est également le titre français du roman), c’est-à-dire un gratte-ciel, de 40 étages, comportant 1000 appartements, et conçu comme une image de la société : les habitants les moins favorisés en habitent les étages les plus bas, tandis que ceux des étages supérieurs appartiennent clairement à une forme d’aristocratie, et tous sont coupés du monde extérieur par l’inutilité de quitter le gratte-ciel, qui propose toutes les commodités imaginables.
Des pannes de courant vont cependant bloquer l’ascenseur qui permet de traverser les étages sans avoir à s’y arrêter et donc à se confronter aux populations des autres classes, et ces ruptures seront l’occasion pour les classes inférieures d’affirmer des revendications sociales dont l’ordre avait jusque-là préservé les étages supérieurs. Assez vite – l’intrigue ne s’étend que sur trois mois – la situation va dégénérer, coupant complètement l’immeuble du monde extérieur, et transformant cette oasis de civilisation en catalyseur des pulsions les plus basses.
Difficile évidemment de ne pas penser à la lecture de ce synopsis au Lord of the Flies de William Golding, publié vingt ans à peine avant High-Rise, et qui racontait comment des enfants civilisés, échoués sur une île, adoptaient un mode de vie tribal et sanglant, renonçant donc bien vite au vernis de l’éducation moderne. Mais on doit songer également à l’expérience de Milgram, conduite entre 1960 et 1963, et surtout à l’expérience de Stanford, conduite en 1971 par Philip Zimbardo, qui démontraient toutes deux la facilité avec laquelle l’homme moderne abandonne tout comportement éthique, et donc la puissance des pulsions dès lors qu’elles ne sont plus écrasées par la conscience. Pulsions qui ne sont peut-être que plus fortes du fait qu’elles ne trouvent jamais à s’exprimer…
Ballard s’appuyait également sur les penseurs du socialisme utopique, phalanstères ou Icaries, dont l’intérêt était certes de gommes les clivages sociaux, mais également de créer des unités indépendantes, microcosmes architecturaux préservant par cette isolation leur pureté des corruptions du monde, tandis que cette idée de gratte-ciels autonomes fait évidemment penser aux cités radieuses de Corbusier, dont le nom officiel est « unités d’habitation », mais qu’il appelait également « villages verticaux », et qui comportent librairie, piscine, boulangerie, épicerie,…

Si les idées sont louables, elles ne font pour Ballard qu’enfermer les individus dans des cocons, et cette désintégration sociale s’accompagne naturellement d’une déresponsabilisation vis-à-vis du monde et d’un éloignement de la réalité dommageable aussi bien pour le monde extérieur, sur lequel nous ne sommes plus capables d’intervenir pertinemment, que pour notre psyché.
Quarante ans après, on pourrait imaginer que ces sujets ont perdu de leur pertinence, pour se rendre compte assez vite non seulement que les logiques consuméristes caractérisant le système capitaliste se sont accentuées, mais que même l’idée de lutte des classes est revenue au premier plan des préoccupations sociales.
Deux films récents l’ont illustrée aussi figurativement que veut le faire Wheatley avec High-Rise, le Snowpiercer de Bong Joon-Ho, qui opposait les wagons les plus proches de la locomotive à ceux qui en sont les plus éloignés, habités par les opprimés, et l’Elysium de Neil Blomkamp, où les riches ont cette fois décidé d’abandonner la Terre pour vivre dans une station orbitale. L’idée d’adopter une forme simple géométriquement pour représenter la division sociale est intéressante parce que simpliste, la narration gagne ainsi par cette linéarité diégétique contrainte par la linéarité géographique une efficacité qu’elle aurait plus difficilement conquise autrement, et cela ajoute assez naturellement au cachet esthétique de l’oeuvre. Atteindre à la beauté d’une parabole, tout en s’intéressant à des trajectoires individuelles, en tentant de mêler identification et allégorie, est aussi paradoxal que stimulant et malheureusement, les deux films, comme le In Time d’Andrew Niccol, qui poursuit les mêmes objectifs, confinent, en schématisme des personnages et du propos, à une naïveté sans transposition possible avec le réel – là où Mad Max : Fury Road, utilisant également la linéarité comme principe tant géographique que diégétique, et appelant de même à une révolte contre les puissants, mais sans lier ces deux principes, parvenait de manière plus convaincante à l’allégorie.
Le pari n’est donc plus neuf, et paraît d’autant plus risqué qu’il est précédé essentiellement par des échecs retentissants, sans être d’avance condamné : le roman de Ballard est une caution scénaristique valable, même si la transposition au cinéma risque évidemment d’individualiser à l’excès par l’importance donnée aux personnages la portée plus générale ; et la linéarité reste un principe prometteur, celle du gratte-ciel étant moins imaginative que celle du train, mais pouvant gagner justement en radicalité si le film tombe dans de bonnes mains.
https://youtu.be/LYmY2tBYins
[divider]What are you doing in there ?[/divider]
Après avoir erré au point de se retrouver entre les mains de Vincenzo Natali, le réalisateur de Cube et Splice se proposant une adaptation très libre du roman, qui sans doute aurait, en flirtant avec l’horreur de ses films, trouvé une tonalité intéressante, High-Rise a non moins curieusement échu à Ben Wheatley. Le réalisateur britannique s’est faire connaître en 2011 avec Kill List, dont il est délicat de parler parce que l’intérêt central s’en trouve dans le total retournement de situation et de tonalité du dernier quart d’heure, après le plus discret Down Terrace et avant Sightseers (Touristes) et A Field in England (English Revolution), tous ces films ayant suscité l’intérêt de la critique et le scepticisme du public. Avouons dans l’ensemble notre plus grand intérêt pour sa filmographie, notre éblouissement en particulier devant A Field in England et notre plaisir devant Sightseers. Avec ses collaborateurs réguliers, sa femme Amy Jump au scénario et au montage et la chef op’ Laurie Rose, Wheatley propose des films caractérisés par leur radicalité : les personnages empêchent toute identification par leur crudité, leur froideur, et ont aussi peu prise sur leur destin qu’ils donnent d’abord une impression de contrôle, parce qu’ils sont toujours dépassés dans leur folie par la folie du monde qui les entoure. Plutôt que de créer une distance par des de longs plans d’ensemble, il privilégie étonnamment une richesse photographique dans la variété des plans, souvent rapprochés et parfois même très gros, composés avec un soin extrême qui tranche évidemment avec la manière habituelle de représenter les classes défavorisées de l’Angleterre. Si High-Rise paraît arborer des couleurs plus chaudes, l’environnement moderne, nouveau dans cette filmographie, suffit à créer, comme dans le Play Time de Tati par exemple, une sensation de froideur, dans un de ces paradoxes entre sensation créée et mise en scène qui font la spécificité du réalisateur.
Wheatley s’est associé pour High-Rise les services du producteur Jeremy Thomas, qui avec la Recorded Picture Company avait déjà participé aux films de réalisateurs aussi passionnants que Linklater, Korine, Cronenberg, Oshima, Miike, Jarmusch, Kitano, Wenders, Gilliam… L’addition de Wheatley à cette liste est donc prometteuse !
L’autre atout majeur du film est le choix de Tom Hiddleston pour incarner le docteur Robert Laing, personnage principal du roman et du film à travers lequel on découvrira la société du gratte-ciel et son chaos. Hiddleston, qui s’est fait connaître comme Loki dans les films Avengers liés à son « frère » Thor, appartient à cette rare liste d’acteurs pour lesquels j’irais voir un film ou une série, aussi peu enthousiasmants en soient tous les autres éléments. Appartenant à cette nouvelle génération d’acteurs britanniques que le monde adule (les Cumberbatch, Redmayne, Tennant…), il s’est également illustré dans le chef-d’oeuvre de Jim Jarmusch, Only Lovers left alive, dans l’adaptation des pièces de la Henriade de Shakespeare par la BBC (The Hollow Crown) et a brillé dans le pourtant bien décevant Crimson Peak de Guillermo del Toro. Il excelle à incarner une classe britannique distante et hautaine, mais dont la contemption aristocratique est ébréchée par une puissante humanité, et on retrouve bien cette puissance d’expression malgré un jeu minimaliste dans la bande-annonce.

Wheatley a su entourer cet excellent choix d’acteurs dont la présence est plus singulière, en quête de reconnaissance et doués mais sans avoir su bien encore affirmer un jeu intéressant chez des cinéastes intéressants : Luke Evans (Bard dans la saga The Hobbit, Dracula dans Dracula Untold, Owen Chase dans les derniers Fast and Furious), dans le rôle ambitieux d’un habitant des étages inférieurs tentant de bouleverser l’ordre social, et Sienna Miller (G.I. Joe, Foxcatcher, American Sniper, mais qui a surtout su gagner la confiance de James Gray et Ben Affleck pour lesquels elle jouera dans The Lost City of Z et Live by Night). Comme Evans, son apparition trop fugitive dans le trailer permet mal de pré-juger de son interprétation, même si elle a su livrer au cours de sa carrière des seconds rôles assez intéressants pour inspirer confiance ici.
Elle jouera le love interest du personnage principal et l’assistante d’Anthony Royal, l’architecte de l’immeuble vivant dans le penthouse, auquel Jeremy Irons prêtera ses traits. Le charisme dur de l’acteur le fait particulièrement remarquer dans ses rôles d’autorité, mais au risque de confiner à la caricature (son rôle dans Donjons et Dragons est bien connu à ce titre) quand l’écriture et la direction ne savent pas en faire usage. Rappelons qu’il était parfait dans Margin Call en directeur de Lehmann Brothers, donc en toute-puissance capitaliste ébréchée par la crise, rôle qui peut faire songer à celui qui sera le sien dans High-Rise, mais on continue d’espérer que l’occasion lui sera donnée de jouer, de sortir de l’hiératisme auquel il semble presque condamné.
En ce qui concerne la bande-son, Wheatley a fait un choix étonnamment prévisible à en juger d’après le psychédélisme de la bande-annonce, mais qui n’en est pas moins parfaitement stimulant : c’est Clint Mansell qui la composera. Si son nom est associé à Mass Effect 3 et à tous les films de Darren Aronofsky, de Pi à Noé, il est surtout connu pour son impressionnant travail sur Requiem for a dream, dont l’ambiance paraît assez bien coller aux premières images de High-Rise, les délires de la drogue laissant leur place aux délires des pulsions libérées de tout carcan social.
Wheatley n’a pour l’heure commis aucun faux-pas, et il paraissait, avec Cronenberg, comme le réalisateur le mieux capable de proposer une adaptation puissante de High-Rise, pour laquelle il a indubitablement mis toutes les chances de son côté en s’entourant impeccablement. On pourrait être plus sceptique en voyant qu’il n’a su recevoir aucune récompense aux British Independent Film Awards, malgré plusieurs nominations, mais il faut admettre la qualité de son concurrent principal au festival, l’Ex Machina d’Alex Garland, et il faut espérer que le jury n’a été surpris qu’à juste titre devant la radicalité du dispositif de Wheatley, et pas qu’il a cette fois échoué comme tant d’autres avant lui dans cette mise en scène plus explicite, plus politique, et plus contrainte par une production moins indépendante que ses précédentes réussites…
Bonus : la conférence de presse pour High-Rise au festival de Toronto !