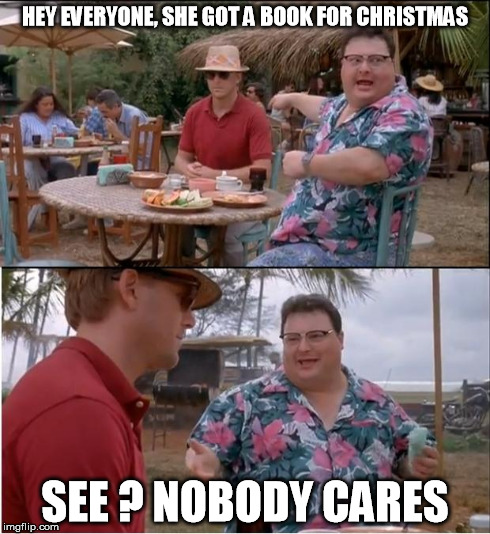A pair of Star Wars lovers speak their lines
Je ne vous ferai pas l’affront de vous demander si la franchise Star Wars vous dit quelque chose. C’est un univers que l’on ne présente désormais plus, et la sortie prochaine du septième volet à la sauce Disney de la saga ravive avec un soupçon d’impatience et d’inquiétude l’engouement des fans. Et la version de Shakespeare, ça vous dit quelque chose ? Heureux les ignorants, puisque nous allons aujourd’hui nous pencher sur cette œuvre bien particulière qu’est William Shakespeare’s Star Wars et qui nous propose de découvrir d’un nouvel œil cet univers familier en nous plongeons dans un autre temps et un autre genre.
[divider]This is not the movie for which thou search’st[/divider]
Puisque j’ai pu voir d’ici certains d’entre vous frissonner à l’évocation du nom de Shakespeare, il me faut rétablir quelques vérités et informations de bases avant de pouvoir poursuivre et plonger davantage dans les détails. Permettez-moi donc de vous raconter une petite histoire.
Noël. Nous sommes le 28 décembre (oui, toute la famille n’était pas disponible le 25. 3615 mylife). Le sapin croule sous les cadeaux, et les petits et grands enfants trépignent d’impatience à l’idée d’arracher les emballages (et accessoirement de découvrir ce que le père Noël a daigné leur déposer). Imaginez ma surprise (somme toute relative, puisque je l’avais explicitement demandé) à la découverte de cet objet jugé archaïque par certains, indémodable par d’autres, qu’est un livre.
Car oui, vous vous en serez douté, William Shakespeare’s Star Wars (Verily A New Hope) est un livre. Eh oui. Et plus précisément, une pièce de théâtre. Et comme vous vous en doutez sans nul doute aussi, il n’a pas été écrit par Shakespeare lui-même (qui, on le rappelle, était un dramaturge anglais à cheval entre le 16e siècle et le 17e siècle). Publié chez Quirk en 2013, notre œuvre est le premier petit bébé d’un certain Ian Doescher, auteur américain contemporain relativement inconnu au bataillon puisqu’il n’a pour le moment à son actif que la première trilogie de Star Wars. Mais nous y reviendrons. Comme nous avons ici à faire non seulement à un texte mais aussi (et pour certains SURTOUT) à un objet, faites preuve d’indulgence, et permettez que je m’intéresse quelques instants à ses caractéristiques.
L’objet est relativement beau. Bien évidemment, il ne peut rivaliser avec les livres à reliure de l’époque, ou avec les livres d’art que le monde de l’édition nous propose de plus en plus, mais ce livre a le don de nous plonger dans l’ambiance et d’ajouter cette petite touche non pas de crédibilité (n’exagérons pas) mais de jusqu’au-boutisme. Théâtre élisabéthain, dites-vous ? De l’élisabéthain vous aurez ! Gravures et fioritures dans des tons sépia vous accueillent dès la première de couverture (sur chemise en papier à grain dans des tons crème s’il vous plaît) et vous donnent tout de suite le ton : il s’agit de donner l’illusion moyennement crédible du vieux (cette illusion fonctionnera bien mieux au niveau du texte lui-même, comme nous le verrons). Cela se confirme lorsque vous retirez la chemise en papier : le carton de la première et de la quatrième de couverture consiste en une imitation de cuir abîmé et vieilli par le temps. Pas de lettres gothiques dorées pour le titre cependant : une typographie très sobre et très contemporaine vient immédiatement contrer l’effet d’authenticité (au cas où l’on n’avait pas encore compris que c’était du faux vieux).

Une fois les premières pages tournées, l’idée d’une simili- authenticité reste exploitée par la mise en page (l’en-tête de chaque page rappelant le nom de l’œuvre et l’acte et la scène dans laquelle on se situe), par les éléments et codes propres au théâtre (didascalies en italique par exemple, ou la présentation des personnages au tout début de l’œuvre) mais surtout par la présence régulière de gravures, que ce soit à chaque nouvel acte ou pour illustrer certaines scènes. Ces illustrations sont en outre très fidèles, que ce soit au genre de la gravure ou à l’univers de Star Wars tel qu’on le connaît dans les films. Elles n’apportent en soi pas grand chose au lecteur familier de l’univers Star Wars, mais nous rappellent (au cas où le texte lui-même ne soit pas suffisant) le contexte élisabéthain de l’œuvre. Je vous dirais bien que les pages sont douces et que l’odeur qu’elles dégagent est subtile et tout aussi douce, mais ce serait laisser parler le rat de bibliothèque en moi.

Le caractère épique de Star Wars, le charme pittoresque du théâtre élisabéthain, le ressenti inimitable d’un livre que l’on feuillète : que demander de plus ?
[divider]To be or not R2-D2 be[/divider]
Eh bien, j’imagine (pour en venir au fond et délaisser derrière nous la forme) que l’on pourrait demander à ce que ce livre soit en français. En effet, première constatation, et non des moindres : le texte est en anglais. Mais attention, comme si cela ne suffisait pas, en anglais shakespearien !
May the Verse be with you
Je ne peux en effet pas vous parler d’une œuvre arborant fièrement le nom d’un des plus grands dramaturges anglais sans m’intéresser à l’aspect linguistique ou du moins littéraire du texte. Car si ce n’est pas Shakespeare lui-même qui a écrit ce texte, c’est tout comme. Cela est sensible dans le titre lui-même (sérieusement, le terme « verily » est tout aussi utilisé que notre « en vérité » biblique), et est approfondi tout au long du texte. Le vocabulaire utilisé et les expressions que l’on peut rencontrer permettent donc de nous replonger dans une littérature élisabéthaine authentique.
Autre élément particulièrement typique de l’écriture de Shakespeare, et qui fait sans doute sa renommée (et son charme ou défaut en fonction de votre point de vue), c’est l’utilisation d’une langue dans son état maintenant jugé archaïque, et qui déjà à l’époque n’était plus vraiment d’actualité : on retrouve ainsi des formes maintenant disparues comme « Thee », « thy », « thou » (qui, pour vous donner de quoi briller en société, correspondaient au « tu » et autres pronoms de la deuxième personne du singulier en anglais moderne naissant ou élisabéthain, le « you » correspondant au « vous » français), ou des formes verbales – elles aussi disparues – comme « art », « dost» (la terminaison –st étant ici la marque de la deuxième personne singulier, associée au pronom « thou » dont nous venons de parler) ou encore « hath ».
Évidemment, on ne peut parler de théâtre shakespearien sans parler versification. Sans nous plonger dans des détails barbants et techniques propres à la versification anglaise (parfois complexe pour nous autres francophones), sachez que l’on retrouve ici le vers shakespearien par excellence, j’ai nommé le pentamètre iambique. Il est un peu au théâtre de Shakespeare ce que l’alexandrin est au théâtre français classique. Si vous vous interrogez sur la nature de ce vers, il est composé de cinq pieds qualifiés d’iambiques en ce que le pied comporte une syllabe inaccentuée suivie d’une syllabe accentuée (précisément dans cet ordre, et rien que dans cet ordre). Je ne vous ferai pas une dissertation sur le système d’accentuation de l’anglais, mais en gros, à l’écoute, un pentamètre iambique, ça donne à peu près : da-DUM da-DUM da-DUM da-DUM da-DUM. Et pour en revenir à ce qui nous intéresse, notre livre William Shakespeare’s Star Wars est bourré de pentamètres iambiques, versification qui implique donc certaines modifications comme des suppressions de lettres dans certains mots ou des structures de phrases alambiquées. Histoire de rendre le pastiche encore plus crédible.
Enfin, je voulais faire mention du travail fait sur les langues étrangères et leur retranscription (très fidèle au demeurant, je vous l’assure pour l’avoir vérifié, livre à la main), parfois presque plus compréhensibles que le texte à la Shakespeare.
[column size=one_quarter position=first ] JAWA 1[/column]
[column size=three_quarter position=middle ]Peska Bahman.
Te peska bahman. Fuligiliha![/column]
[column size=one_quarter position=first ] R2-D2[/column]
[column size=three_quarter position=middle ]Ahh! Beep, beep, squeak, beep, beep, ahh![/column]
(Extrait de William Shakespeare’s Star Wars – Verily A New Hope, Acte I scène 4, v.69 à 71)
Verily not a new story
Si la fidélité à la plume de Shakespeare est indéniable, qu’en est-il de l’histoire elle-même et de l’univers dont elle s’inspire (pour ne pas dire copier) ? Sachez tout d’abord que cette œuvre n’a pas été faite à la sauvage, dans une cave aussi glauque que miteuse par un petit geek du dimanche. Si vous craignez pour la franchise Star Wars, rassurez-vous : outre le petit sigle ® (Marque déposée enregistrée) apposé – en tout petit, certes, mais en première de couverture tout de même – au titre Star Wars, soulignons que Ian Doescher a travaillé de concert avec Jennifer Heddle notamment, dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais qui travaille au sein de LucasBooks, branche spécifique de Lucasfilm Ltd. chargée de la production et du suivi des œuvres utilisant partiellement ou complètement l’univers Star Wars. Mais si cet aspect théorique et juridique ne vous suffit pas, jetons un coup d’œil au déroulement de la pièce elle-même.
S’il vous faut retenir une seule chose de cette réflexion, c’est que la pièce n’est on ne peut plus fidèle au film. Alors bien sûr, il me faudra nuancer mon propos. La fidélité de l’adaptation tient à l’intrigue elle-même. Pas une seule histoire d’amour n’a été rajoutée, pas un seul personnage n’a été oublié au casting (sauf peut-être un ou deux Stormtroopers). De ce point de vue là, Ian Doescher a suivi à la lettre l’histoire, celle-ci suivant tout le temps son cours, ou presque. En effet, à quelques reprises (mais elles se comptent sur les doigts de la main), certaines scènes sont légèrement réorganisées et déplacées, mais jamais bien loin de leur situation de départ, et cela se justifie par des raisons très terre-à-terre sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard.

Il faut cependant aussi souligner quelques autres modifications au texte lui-même. Évidemment, le passage d’une langue contemporaine à une langue plus archaïque modifie forcément le texte, comme nous l’avons vu. Non, je parle ici davantage du contenu que de la forme du texte. En effet, si je vous soulignais que le texte était particulièrement fidèle et que rien n’avait été spécifiquement retiré ou rajouté à l’intrigue elle-même, on ne peut pas en dire autant du texte. Le texte a en effet été intégralement repris, à l’exception de trois ou quatre phrases. Et je ne dis pas cela en guise d’euphémisme – je vous laisse en effet m’imaginer, devant le film, le livre à la main, comparant le texte dit au texte écrit, en mettant sur pause dès qu’il me fallait me noyer dans une tirade inconnue avant de retrouver le fil officiel de l’histoire, faisant ainsi passer la durée du film de 2h à pas loin de 5h.
Car si je n’ai réellement noté que de rares coupures (et encore une fois, elles se montrent justifiables, justifiées, et non pénalisantes), les ajouts sont quant à eux très nombreux. En effet, pour une phrase prononcée à l’écran, il faut en compter le double ou le triple en moyenne à l’écrit (pourquoi faire court quand on peut faire long), résultant en un total de 3 076 vers. Cela s’explique bien évidemment par les contraintes stylistiques de versification et de langue, mais pas seulement. Que ce soit un instrument pour combler le manque dû à un changement de support, ou pour accentuer la qualité du pastiche, ou pour glisser de nombreuses références intertextuelles, le texte ajouté ne modifie en rien l’intrigue principale, et a même tendance à approfondir certains points. Les élans initiatiques de Luke nous sont ainsi révélés, mais aussi les poussées lyriques maléfiques de Darth Vader (ou Dark Vador pour nous autres francophones), ou encore le sarcasme jusque là inconnu de R2-D2 (qui en effet a pour l’occasion et à certaines occasions le droit à une voix – intelligible – propre). C’est une toute nouvelle vision des personnages qui nous est offerte ici, et c’est assez rafraîchissant.

Notons que les principales modifications que l’on peut mettre en avant entre le film de George Lucas et son adaptation écrite par Ian Doescher ne viennent à aucun moment modifier l’histoire elle-même, mais viennent la compléter : principalement pour des raisons pratiques, elles sont généralement utilisées à bon escient
So shall I trust the Verse
Mais à force de vous parler de la pertinence des modifications mentionnées ci-dessus, il serait temps de vous expliquer en quoi le déplacement d’une scène ou l’ajout d’un monologue est nécessaire et suffisant dans notre œuvre. Si le théâtre élisabéthain n’est pas soumis à la règle des trois unités (de lieu, de temps et d’action) que chérit notre théâtre classique français de l’époque, il est cependant soumis à des contraintes bien réelles : changements de décors et prouesses techniques propres au monde du théâtre limitent le champ des possibles. Il n’est donc pas envisageable, au milieu d’une scène dans le camp des rebelles, de faire un saut au cœur du vaisseau spatial des méchants pour voir Dark Vador se frotter les mains en rigolant, avant de revenir aux côtés de Leia, Luke et toute la bande. Cette scène est donc soit tout simplement coupée, soit légèrement déplacée de façon à être rapprochée d’une scène sur ledit vaisseau spatial des méchants (et c’est généralement la deuxième solution qui est préférée).
Ces contraintes justifient par ailleurs généralement le découpage des scènes et des actes (de l’ordre de cinq) de l’œuvre, même si ce découpage se révèle parfois assez inégal, du moins à l’échelle du film (avec des actes durant respectivement 26, 17, 20, 40 et 30 minutes) : il faut cependant garder en tête que le rythme du film n’est pas forcément le même que celui de la pièce. En effet, il faut tenir compte des scènes purement et exclusivement visuelles dans le film (comme la capture de R2-D2 – no spoil – qui se révèle bien plus longue dans le film puisque l’on a tout un aperçu de l’univers visuel des Jawas) que l’on perd dans la pièce, mais qui sont en contrepartie compensées par les ajouts de textes. C’est justement cette perte qui justifie ET l’ajout de longues tirades ou monologues, permettant d’accentuer l’effet dramatique, ou romantique, ou épique de certains passages qu’un simple effet cinématographique, comme un zoom par exemple, suffit à rendre, ET l’apparition d’un tout nouveau personnage (si l’on peut le nommer ainsi) qu’est le chœur (chorus en anglais).

En effet, je n’en ai pas parlé jusque là, mais il est à noter que, conformément au théâtre de l’époque, et ce sous une influence antique certaine, une voix extérieure à l’histoire est souvent matérialisée, dont le rôle tantôt descriptif, tantôt critique, voire moralisateur, permet ici de rendre visuel ce que le théâtre ne peut matérialiser : scènes de combat, déplacements à travers l’espace, simultanéité d’événements… C’est notamment le chœur qui prononce le prologue, qui n’est ici rien d’autre que le texte défilant au début du film, ou qui nous décrit l’effet de la Force, difficile à mettre en scène à l’époque de Shakespeare.
Il faut le reconnaître, les subterfuges sont plutôt intelligents, et l’œuvre fait une transition plutôt tranquille entre film et livre. Cependant, il faut reconnaître une faiblesse majeure : on perd un peu (voire beaucoup) du caractère épique de Star Wars. Si la langue de Shakespeare a un quelque chose de lyrique, l’absence de musique, de bruitages et d’effets spéciaux lors de la lecture se fait sentir. Qu’il nous paraît lointain, le bruit du sabre laser tranchant les airs (ou les gens, au choix) !
[divider]Ce qu’il faut en retenir[/divider]
On ne peut s’empêcher de remarquer que l’adaptation shakespearienne se prête particulièrement bien à l’histoire de Star Wars. Ou serait-ce l’histoire qui se prêterait particulièrement bien à Shakespeare ? Les deux à vrai dire puisque que Ian Doescher a remarqué (et si bien dit dans son « Afterword ») que Star Wars suivait de façon très précise le schéma narratif de Shakespeare, et pour cause. George Lucas, nous explique-t-il, s’est fortement inspiré du travail de Joseph Campbell, qui a étudié ces motifs narratifs récurrents à travers toute l’histoire de la littérature, de l’antiquité à nos jours (Shakespeare y compris, puisque son œuvre servira pleinement à son étude). L’œuvre de Shakespeare suivant elle-même des codes précis établis depuis des générations, il est donc peu étonnant que les personnages de Star Wars résonnent en nous (et dans des œuvres de Shakespeare, mais d’autres dramaturges de façon plus générale) : on retrouve ainsi le couple tant aimé du théâtre (pensons à Rosencrantz et Guildenstern chez Shakespeare, mais aussi Vladimir et Estragon chez Beckett) en la nature du couple formé par C3-PO et R2-D2, les méchants, les sages, les jeunes hommes en quêtes personnelles, et j’en passe. C’est aussi pour cela que l’on retrouve à la fois les éléments de la comédie, de la tragédie, ou de la pièce historique. L’importance du destin et de la destinée n’est pas non plus négligeable.
Si le résultat est très réussi, il faut aussi lui reconnaître quelques faiblesses. À la façon d’un troisième œil qui nous pousserait au milieu du visage, on peut notamment s’interroger sur la tirade de Luke au début de la scène 6 de l’acte IV : si la référence au très célèbre soliloque de Hamlet (dans la pièce éponyme de Shakespeare) est plus qu’évidente, elle semble cependant loin d’être pertinente. Elle paraît même tombée de nulle part, et l’on serait tenté de passer outre. À trop vouloir faire, l’auteur s’est parfois égaré.

Lire ce bouquin, c’est comme lire Shakespeare : on sait de toute façon comment ça va finir. Ça tombe bien, le livre donne en plus l’impression d’être un Shakespeare. C’est une œuvre globalement très réussie, très rafraîchissante, et qui se lit très bien pourvu que l’on s’accroche et que l’on surmonte l’obstacle linguistique.
Et vous, qu’en avez-vous pensé ?